
Justice de l’urgence (1/2). Sept appels téléphoniques s’affichent en file d’attente sur l’écran d’ordinateur. A chacun son code couleur en fonction de l’urgence : le rouge, c’est la découverte d’un cadavre ou l’heure limite d’une garde à vue ; le bleu, une garde à vue en cours ; le jaune correspond au suivi des enquêtes préliminaires ou en flagrance et aux auditions libres. Ecouteurs sur les oreilles, telle une téléopératrice, Audrey Trafi répond toute la journée aux policiers et aux gendarmes de la Haute-Garonne. Vice-procureure à Toulouse, elle est de permanence, cette semaine, au service du traitement en temps réel des majeurs. Et il lui faut sans cesse prendre des décisions…
Premier dossier : un conflit conjugal du côté de Villefranche-de-Lauragais. « Les violences ne sont pas graves, mais elle est enceinte de cinq mois, ce n’est pas à elle de quitter le domicile et c’est elle qu’il faut protéger », résume Mme Trafi après le compte rendu que vient de lui faire une gendarme de la brigade locale. L’homme, en garde à vue depuis la veille, ne reconnaît pas avoir frappé sa compagne. « Il l’a peut-être bousculée sans faire exprès », suggère la gendarme. Mais l’intéressé a déjà trois antécédents de violence signalés.
Cette fois, c’était en pleine nuit. En se rendant aux toilettes, la jeune femme l’a trouvé endormi à la selle. Elle l’a réveillé, il l’a bousculée en sortant, au point de la faire tomber. « Ça arrive quand il boit trop, il supporte mal le caractère autoritaire de sa compagne, précise l’enquêtrice.
– Il boit régulièrement ?, interroge Audrey Trafi.
– Oui, mais normalement. » Cette fois, il était saoul au point de s’endormir dans les toilettes ; sa compagne a préféré partir du domicile avec leur enfant de 3 ans.
En cinq minutes d’entretien téléphonique, deux éléments ont retenu l’attention de la magistrate : la réitération des faits et l’attitude du mis en cause, soucieux de minimiser sa responsabilité. Pour la vice-procureure, le moment est venu de trancher : « Vous pouvez lui dire qu’il se trouve un logement pour ce soir ! » Il sera déféré l’après-midi même au parquet, lequel demandera son placement sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rendre au domicile conjugal et d’entrer en contact avec la victime d’ici à l’audience de jugement.
La création du service de traitement en temps réel (TTR) remonte aux années 1990. Les plus grandes juridictions entendaient ainsi faire face au volume des affaires à traiter. Depuis, il s’est généralisé à tous les parquets.
Cette permanence téléphonique leur permet de diriger les enquêtes judiciaires confiées aux services de police et de gendarmerie. C’est un peu la gare de triage de la justice, l’endroit où se décide, sans la personne concernée ni son avocat, l’orientation procédurale de son dossier : classement sans suite, alternative aux poursuites, comparution immédiate, ouverture d’une instruction… En octobre 2018, l’Inspection générale de la justice écrivait, dans un rapport, que cet « outil de gestion des flux » était devenu « la principale voie d’entrée des affaires, des crimes aux infractions routières ».
procureur de la République adjoint à Lorient
« Le cœur du réacteur », comme le décrit le même document, se situe au quatrième étage du palais de justice de Toulouse, à l’unique étage du tribunal de Lorient (Morbihan) ou au onzième de celui de Créteil. Des lieux sécurisés et fermés au public dans lesquels Le Monde a été autorisé à passer plusieurs jours.
A Toulouse, Audrey Trafi prend des décisions à un rythme soutenu : sur le sort d’un jeune interpellé à la gare de Matabiau avec 3 grammes de résine de cannabis ; sur les recherches à lancer dans la Garonne avec les pompiers après la disparition inquiétante d’une trentenaire ; sur le choix de la réponse pénale pour des vols à la roulotte sur un parking…
La liste des décisions à prendre est sans fin, un vrai manège. Cela va du renouvellement par visioconférence d’une garde à vue à la réquisition d’un médecin légiste après la découverte d’une pendue de 67 ans, en passant par la demande de pose d’une balise de géolocalisation sur une voiture dans une enquête sur un trafic de cocaïne…
Les chiffres donnent la mesure du défi : selon les décomptes de Dominique Alzeari, procureur de la République à Toulouse, les vingt-quatre magistrats de son parquet ont eu à traiter en 2018 plus de 9 000 gardes à vue et 30 000 affaires « poursuivables ».
Egalement de permanence au TTR cette semaine, Pierre de Monte pose un instant son casque pour rejoindre, au bout du couloir, une pièce sans âme, le « bureau de défèrement ». Il y reçoit, avec sa casquette de procureur qui fixe les peines, une conductrice de 24 ans interpellée la veille, sans permis ni assurance, au volant sa voiture. « Cette fois, une peine d’emprisonnement ferme s’impose », lui annonce le vice-procureur.
Coincée sur une chaise, entre le bureau et les deux policiers plantés derrière elle, cette jeune femme aux yeux bleus, aux cheveux blonds tirés derrière la nuque, paraît apaisée, mais elle peine à se remettre d’une mauvaise nuit et de vingt-deux heures de garde à vue.
Lors du compte rendu téléphonique de l’agent du commissariat central de Toulouse, le matin même, le magistrat avait opté pour une procédure de plaider-coupable avec convocation immédiate. En jargon judiciaire : une CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité) sur défèrement. « On aurait pu la convoquer dans les six mois à une audience correctionnelle à juge unique, mais la stratégie du parquet, depuis deux ans, est de développer les CRPC défèrements », explique-t-il.
La jeune femme accepte la peine proposée de trois mois. Elle sait ce qu’est une CRPC : l’avocat commis d’office l’a vue quelques minutes pour le lui expliquer. Lui-même ne fait pas d’observation. « Le positif est que, cette fois, il n’y avait pas d’alcool », relève le magistrat, en référence à une précédente condamnation. La sanction sera bientôt homologuée, le temps pour l’avocat et sa cliente menottée de se rendre à l’étage du dessous, devant le juge des libertés et de la détention (JLD), un juge du siège, statutairement indépendant.
Au TTR de Toulouse, tout a été pensé pour aller vite. Trois greffiers et une étudiante en master de droit, juriste assistante, partagent le bureau où les uns décident et les autres mettent en forme les convocations judiciaires et les réquisitions au JLD. Un grand écran au mur liste les défèrements du jour. Sur le tableau voisin, neuf noms ont été inscrits au feutre rouge : tous ceux-là seront jugés en comparution immédiate, demain, à l’audience de 13 h 30. « Généralement, on fait en sorte de s’arrêter à douze », précise Mme Trafi.
De fait, les capacités d’absorption des audiences de comparution immédiate ne sont pas extensibles. « On ne bâtit pas une politique pénale sans tenir compte de ce qu’il se passe à chaque maillon de la chaîne », confirme Matthieu Thomas, procureur de la République adjoint à Lorient. « La CRPC n’a que des avantages pour la gestion du greffe correctionnel, ajoute-t-il. C’est une ordonnance à taper plutôt qu’un jugement complet. » Rien que dans le tribunal morbihannais, leur nombre (570 en 2018) a été multiplié par six en quelques années.
Tout ce qui se passe en amont du TTR a également son importance, à commencer par le compte rendu téléphonique des faits, porte d’entrée dans la machine pénale. Compte tenu des cycles horaires en vigueur dans les brigades et les commissariats, ce « résumé » n’est pas toujours délivré par l’agent ayant procédé à l’audition du gardé à vue. D’où, parfois, une présentation imprécise de la situation… Les magistrats du parquet s’en contentent souvent, sans avoir le temps de lire les procès-verbaux, pourtant les seuls éléments à faire foi. « Ma hantise, c’est l’erreur qui conduit à la détention arbitraire, ou de passer à côté de quelque chose dans un meurtre maquillé », admet Audrey Trafi à Toulouse.
Dans certains endroits, l’engorgement a de quoi effrayer, mais il faut avancer, encore et encore. A elle seule, la division des affaires générales et des stupéfiants (Dages) du parquet de Créteil (Val-de-Marne), chargée des crimes, des violences, des cambriolages, des délits routiers comme des trafics de stupéfiants, a reçu 56 725 appels en 2018 ! La division des affaires familiales et des mineurs (Dafmi) en a, elle, reçu plus de 21 500. Autant dire que dans le lot des « erreurs d’aiguillage » sont possibles. « Ce week-end, j’ai déféré deux personnes pour vol avec violence sur la base d’un compte rendu oral, mais le collègue qui a eu le dossier avec les PV le lendemain a vu que ça ne tenait pas et a requis la relaxe à l’audience de comparution immédiate », reconnaît Juliette Thiery, jeune substitut du procureur à Créteil.
Dans ce tribunal de la banlieue sud-est de Paris, le bureau du TTR est exigu. Ses murs sont jaunis et la moquette usée jusqu’à la déchirure. Par la fenêtre, l’unique touche de couleur dans un décor d’entrepôts et d’usines est le logo du siège social d’un groupe de spiritueux. A voir les chemises cartonnées scotchées sur la fenêtre pour suppléer les stores cassés, le visiteur se dit que le soleil doit tout de même briller de temps à autre.
Ce jeudi, Sébastien Piffeteau, le patron de la Dages, a pris 122 appels avec sa collègue de permanence, installée de l’autre côté du couloir. Sur son caisson à tiroirs trône une grosse chemise étiquetée « Autorisation de destruction de produits stupéfiants » avec des centaines de PV empilés, tandis qu’est posé sur le rebord de la fenêtre un épais classeur « Livraisons surveillées ». « Le soir, je ne raconte pas ma journée, avec toutes les merdes qu’on voit », prévient le magistrat, soucieux de cloisonner le professionnel et le privé. La preuve : rien de personnel ne vient égayer son bureau. « Ma vie perso n’est pas là ! »
Après avoir validé le devis à 1 500 euros d’un laboratoire chargé d’analyser la pureté de 130 grammes d’héroïne saisis le matin et signé dans la foulée trois permis d’inhumer, M. Piffeteau enchaîne sur un appel du commissariat de Créteil. Une affaire de « stups », à nouveau. Au bout du fil, un policier lui résume la situation.
« Julien M., en garde à vue depuis 17 h 45 hier, refuse de donner en audition le nom de son commanditaire, le fameux “J” dans son répertoire, qu’il appelle avant chaque livraison. Mais il met son appli Signal [messagerie cryptée] le jour où commencent les livraisons.
– On est bien sur un livreur qui travaille avec un “central shit” ?
– Oui, il fait six à sept ventes de cocaïne par jour au tarif de 60 euros le gramme. Sa rémunération est de 40 euros par jour. Il avait 920 euros sur lui. En perquisition, on a trouvé 2 200 euros et huit bonbonnes de cocaïne.
– Il vend sur quelle zone ?
– On l’a interpellé lors d’une transaction à Champigny, mais la plupart des livraisons sont sur Paris. L’historique de son Waze [application mobile GPS] et le bornage du téléphone correspondent. »
Le magistrat constate que cet individu n’a aucune condamnation au casier.
« Et le commanditaire ?
– Sa ligne borne dans le 93.
– Ils ont des magistrats très compétents à Bobigny, ils s’en chargeront… Comme il a tout reconnu, je pourrais faire une CRPC, mais il y a beaucoup d’argent, et je ne veux pas discuter cent sept ans. On va aller en comparution immédiate, vous me le déférez à 21 heures. »
patron de la division des affaires générales et des stupéfiants (Dages) du parquet de Créteil
Vouloir évacuer rapidement le flux des dossiers impose parfois de renoncer à des actes d’enquêtes complémentaires, comme ici tenter de remonter au commanditaire. Les procureurs n’aiment guère voir des enquêteurs mobilisés des mois durant pour un résultat incertain. Si ce type de dossier n’est pas bouclé en flagrance, personne ne sait quand il le sera… « L’enjeu de la justice, c’est la maîtrise du temps, explique le vice-procureur à la carrure de rugbyman. Pendant l’enquête préliminaire, le temps est maîtrisé par le parquet, pendant l’information judiciaire, il l’est par la défense. Notre objectif est donc de peser sur les enquêtes, de les orienter pour boucler des préliminaires en trois mois et éviter les instructions. »
Un raisonnement implacable que confirme, à 500 kilomètres de là et dans un contexte très différent, la procureure de Lorient, Laureline Peyrefitte : « Une bonne justice est d’abord rendue dans des délais raisonnables. »
Retour à Toulouse, cette fois au parquet des mineurs. Marion Escudier, sortie de l’Ecole nationale de la magistrature (ENM) il y a dix-huit mois, virevolte entre son bureau, l’imprimante qui crache des PV et le tableau sur lequel elle met à jour les gardes à vue du moment, tout en poursuivant ses échanges téléphoniques, casque sur la tête.
Un appel lui donne du souci. Le commissariat vient de la prévenir qu’une gamine de 16 ans avait été admise aux urgences pour une overdose d’ecstasy. La magistrate connaît bien cette ado : elle avait demandé son placement dans le cadre d’une affaire d’atteinte sexuelle par ses frères. D’autres cas de mineures droguées à l’ecstasy ayant déjà été signalés dans le même quartier, une inquiétude commence à poindre : ces ados, une fois droguées, seraient-elles forcées de se prostituer ? La substitut Escudier en discute avec sa hiérarchie. La décision tombe : à ce stade, ce sera l’ouverture d’une enquête préliminaire sur le trafic de stupéfiants. « On n’a pas assez d’éléments pour ouvrir une information judiciaire pour proxénétisme. »
Dans ces moments-là, le travail en équipe, propre au parquet, n’est pas un vain mot. « Notre métier, c’est prendre des décisions, vite, résume M. Piffeteau, à Créteil. C’est une gymnastique intellectuelle, mais quand on a une zone de doute, on consulte. On a une hiérarchie pour valider nos orientations. »
Un message WhatsApp (application mobile de messagerie partagée) vient interrompre la conversation. A Créteil, la magistrate chargée de représenter cet après-midi le parquet aux comparutions immédiates se sert discrètement de son smartphone pendant l’audience pour solliciter ses collègues sur une nullité de procédure soulevée par un avocat. Pareille question ne reste jamais longtemps sans réponse grâce au « Parquet flottant », ce groupe fermé sur WhastApp que les magistrats de la Dages ont créé entre eux.
« On n’a pas toujours assez de temps de cerveau disponible pour examiner chaque cas à fond, mais on n’est jamais seul face à une situation délicate », dit Elsa Jacquemin. A 46 ans, cette ex-avocate est magistrate depuis dix-huit mois, après avoir réussi le concours complémentaire de l’ENM. A contre-courant des discours sur la souffrance au travail des magistrats du parquet, pressurés par des horaires et des rythmes soutenus, elle estime travailler dans un cadre protégé. « La sécurité de l’emploi est en soi un élément fantastique. Ailleurs, on travaille plus, avec autant de responsabilités, mais sans les mêmes garanties », assure-t-elle, au risque de se froisser avec quelques collègues…
A Lorient, le rythme est moins stressant. Le vice-procureur Eric Pouder a tout de même reçu vingt-cinq appels dans la journée. Ici, pas de central téléphonique numérique, mais une fonctionnaire de justice chargée de filtrer les coups de fil et de hiérarchiser les priorités.
Les situations à démêler ne sont pas plus simples qu’ailleurs et sa permanence téléphonique, commencée le lundi à 9 heures, court non-stop jusqu’au vendredi à 14 heures, l’obligeant à rentrer chez lui avec le téléphone du parquet.
Hier soir, cette permanence n’a pas été de tout repos. Le commissaire principal l’a appelé à 23 h 15 pour des tirs de kalachnikov à Hennebont, dans une petite cité où le trafic de drogue a pris, ces derniers temps, un tour violent. C’était la première fois que des armes de guerre y étaient utilisées. Huit douilles de 7,62 mm et une de 9 mm ont été retrouvées sur place. Les premiers éléments de l’enquête de voisinage sont contradictoires. Certains ont vu un homme seul à bord d’une BMW tirer en l’air, mais, à en croire un autre témoin, ils étaient deux et visaient un homme à pied qui a pu s’enfuir…
A Lorient comme ailleurs, le traitement en temps réel ne concerne pas toujours des événements récents. Ainsi, ce matin de printemps, c’est une affaire remontant à plus d’un an et demi qui s’invite au programme matinal du parquet. Un jeune homme de 21 ans vient d’être placé en garde à vue à la suite d’une plainte pour viol déposée par son ex-petite amie. La plainte date de novembre 2017. Quant aux faits en question, ils dateraient de la fin 2016.
vice-procureure au parquet de Toulouse
Ces deux-là s’étaient rencontrés par Internet alors qu’ils avaient tout juste 18 ans et sont sortis ensemble quelques mois, « avant de s’engueuler sur le prénom des enfants… qu’ils n’ont jamais eus », raconte le gendarme au téléphone. La jeune fille a voulu cesser la relation, pas son compagnon. Son audition ne donne rien. « Il nie, mais je ne sais pas si c’est du lard ou du cochon », reconnaît, embêté, l’enquêteur.
La plainte déposée en Loire-Atlantique, transmise à Lorient, a tardé à être traitée pour des raisons d’effectifs… Mais surtout, décrypte M. Pouder, « dans ce type d’affaires, la garde à vue doit être la dernière étape de l’enquête, et là, on n’a rien à opposer à un type qui nie, la garde à vue ne sert à rien ! L’officier de police judiciaire de Nantes aurait dû aller chercher si la victime en avait parlé à des proches au moment des faits et demander son expertise psychologique pour voir s’il y a un traumatisme. C’est catastrophique pour la victime, à qui on va dire qu’on a mis seize mois pour en arriver là. Vous levez la garde à vue et vous me transmettez le dossier. »
Sans grande conviction, le magistrat va retourner le dossier à Nantes avec des instructions précises pour des actes d’enquête complémentaires. Après dix ans de parquet, notamment à Vannes et à Grasse (Alpes-Maritimes), M. Pouder estime avoir « l’expérience pour prendre ses responsabilités en classant sans suite un dossier bancal plutôt que de le renvoyer, dans le doute, au tribunal ».
Parfois, des éléments de preuve arrivent sur un plateau. « Heureusement qu’ils sont un peu débiles, sinon on ne les aurait jamais », se réjouit le policier de Saint-Maur-des-Fossés au téléphone avec le TTR de Créteil. Un jeune homme, interpellé avec un peu de cannabis et 1 700 euros sur lui, a dans son téléphone une photo où on le voit en train de peser de la drogue ! Quarante-huit heures de garde à vue auront néanmoins été nécessaires pour réunir tous les éléments avant de le renvoyer en comparution immédiate.
Les différents clignotants sur son cas ont tous viré au rouge : le test urinaire aux stupéfiants est positif, tandis que ce jeune homme « sans ressources », chez qui d’autres sommes d’argent ont été saisies, a déjà été condamné de multiples fois pour usage et, en 2017, pour vente de stupéfiants. « Il avait été condamné à huit mois ferme, il a dû bénéficier d’un aménagement de peine, mais il s’en tamponne ! Cette fois, on va demander le mandat de dépôt », précise le magistrat, c’est-à-dire l’incarcération à l’issue de l’audience.
A côté du flot des dossiers liés aux stupéfiants et aux affaires de violences conjugales, auxquels les parquets sont chargés d’apporter une réponse pénale, la délinquance routière fait partie des infractions les plus fréquentes. Mais pour les délits les plus simples, cela passe par le « TTR électronique », autrement dit par courriel.
A Lorient, la personne qui gère ce type de dossiers s’appelle Isabelle Lebreton. Entrée grâce à un emploi jeune au tribunal de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) en 2000, elle a passé les concours internes et est désormais greffière assistante du magistrat.
Sa bible, le « Memento de politique pénale », est un épais classeur concocté par le procureur, recensant les orientations à suivre pour chaque type d’infraction. Un barème du nombre de mois de suspension de permis est par exemple établi en fonction du taux d’alcoolémie. « En concertation avec le préfet du Morbihan et le procureur de Vannes, j’ai rehaussé en 2018 le barème pour la conduite en état alcoolique », précise la procureure de Lorient, en raison d’une augmentation de la mortalité routière.
Ce matin, Mme Lebreton reçoit le dossier d’un quinquagénaire interpellé la veille lors d’un accident de la circulation avec 3,21 g/l d’alcool dans le sang. Une ordonnance pénale (sanction sans débat) aurait pu suffire car il n’est pas en récidive légale, sa précédente condamnation remontant à plus de cinq ans. Mais vu son niveau d’alcoolémie, celui d’un coma éthylique, c’est une CRPC que la greffière va proposer au magistrat de permanence.
Autre affaire arrivée par le TTR électronique : un jeune chauffard récidiviste, « flashé » à 158 km/h au lieu des 110 km/h autorisés, positif aux stupéfiants et à l’alcool. Pour Mme Lebreton, le barème est clair : transmission aux gendarmes d’une convocation pour une audience correctionnelle dans trois mois et, en attendant, immobilisation judiciaire du véhicule, une Audi A4 cabriolet.
Habitués à trancher rapidement, ces magistrats ne sont pas à l’abri des bourdes. A Toulouse, par exemple, alors qu’au téléphone Audrey Trafi fait le point avec un commissaire sur une enquête en cours concernant une série d’attaques de commerces, la voici qui s’exclame d’un coup : « Merde, mais les écoutes téléphoniques sont totalement illégales ! »
Le code de procédure pénale autorise les écoutes en enquête préliminaire pour des infractions « en bande organisée », pas pour « association de malfaiteurs » ni pour « vol aggravé »… Le parquetier de permanence avait fait une erreur. Le JLD, censé être le garant des libertés individuelles face aux prérogatives du parquet, n’a rien vu et a donné son feu vert. « Ils n’ont pas le temps de vérifier ce qu’on fait, souligne la vice-procureure. C’est pour ça qu’on ne doit pas se planter. »
C’est le danger du TTR et des décisions à la chaîne qu’il impose. Mais cette pression est la rançon de l’excitation et du plaisir que ces magistrats prennent à être « sur la ligne de front, en prise directe avec la réalité pénale » (Sébastien Piffeteau), « au centre du truc, à démerder pas mal de situations » (Audrey Trafi), convaincus que « le vrai pouvoir judiciaire, c’est le parquet » (Eric Pouder). En revanche, « quand il y a des problèmes dans la procédure, les collègues du siège ne sont pas les derniers à nous tomber dessus, il n’y a pas que les avocats, regrette Audrey Trafi. Le parquet sert de paillasson à qui veut bien s’y essuyer les pieds ».
Nombre d’entre eux vivent mal l’image que renvoie la différence de statut avec les juges du siège, ceux qui jugent, dont l’indépendance est garantie. « Comme s’il suffisait de passer du parquet au siège pour devenir du jour au lendemain un magistrat indépendant et formidable », résume la procureure de Lorient.
Une fois leurs dossiers bouclés, ces parquetiers, rouages essentiels du traitement de la délinquance, ont le sentiment du devoir accompli. Même s’ils savent bien que, derrière, la qualité de la défense et des audiences, donc de la justice, sera inégale.
Jean-Baptiste Jacquin
► L'article a été publié le 26 juin 2019 sur lemonde.fr.
► Il n'existe aucun lien personnel, professionnel ou commercial entre l'auteur de l'article, son journal et le créateur de ce site, ayant simplement trouvé cet article par ses recherches et l'ayant sélectionné pour sa pertinence et sa qualité.
► Les problèmes décrits sont toujours d'actualité et identiques à Montpellier, comme partout en France. Heureusement, certains ont pensé à ramener de la poudre aux yeux.
► Amalgames et généralisations sur quiconque sont déconseillés, le vice (ou la vertu) peut apparaître partout.

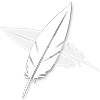 situation identique —
situation identique —